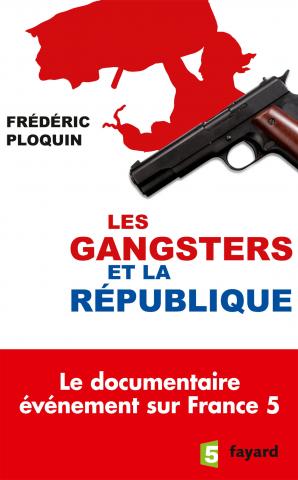Les voyous traqués par la police de la République ? C’est la version officielle. La face cachée, ce sont des décennies de services rendus ! La France a toujours eu besoin des gangsters pour effectuer les basses besognes que les services officiels ne pouvaient accomplir. Ce sont ces petits arrangements entre amis que décrypte ce livre, sur une période s’étendant de l’Occupation à aujourd’hui, en passant entre autres par le Service d’action civique (SAC), la guerre d’Algérie et le Marseille de Gaston Defferre.
Comment la brigade mondaine a couvert les hôtels de passe en échange de précieux renseignements ? Comment le milieu corse a fait main basse sur les cercles parisiens au lendemain de la Libération ? Comment a-t-on échangé une forme de paix sociale dans les quartiers contre la mainmise des dealers sur leurs territoires ? Comment la République s’est-elle servie des voyous, tout en les laissant se servir allègrement ?
Réponses avec les témoignages exclusifs de politiques de tous bords (de Charles Pasqua à la sénatrice de Marseille Samia Ghali), de policiers (de Lucien Aimé-Blanc, ancien de la mondaine, à Bernard Squarcini, ex-patron des RG), de gangsters de toutes les générations, mais aussi d’historiens et de criminologues.
Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police et de justice, est l’auteur aux Editions Fayard de la série Parrains & caïds consacrée au banditisme. Journaliste à Marianne, il est l’auteur de la série diffusée sur France 5 sur les gangsters et la République.
Depuis 1945, les liaisons dangereuses qui unissent caïds, police et monde politique ont marqué l’histoire nationale et continuent de façonner le banditisme français. Cette série documentaire en trois volets, signée Julien Johan et Frédéric Ploquin, propose une relecture inédite de l’histoire française contemporaine.
La France a toujours eu besoin des voyous pour effectuer les basses besognes, mais jusqu’à quel point les politiques sont-ils prêts à aller pour l’amour de la patrie?
Joe Attia, Georges Boucheseiche, Henri Lafont, comment les grands noms de la « Carlingue » ont-ils repris du service pendant les années de Gaulle pour jouer les barbouzes pour l’État ?
De la disparition de Ben Barka aux affaires liées au mouvement indépendantiste corse, à chaque fois que l’intégrité de la nation s’est 1 trouvée menacée, les politiques ont eu recours aux caïds. Les voyous racontent ces liaisons dangereuses solidement tissées pendant la Seconde Guerre mondiale, les risques, les réussites et les dérapages.
Episode 2 : Petits arrangements entre amis
Proxénétisme, braquage et jeu : les trois grands secteurs de la voyoucratie française. De la grande époque des maisons closes, quand la Mondaine fermait les yeux en échange de précieux renseignements, à celle des cercles de jeu parisiens, généreusement octroyés au milieu corse par l’État au lendemain de la Libération, en passant par le Marseille Defferre-Guérini, comment flics, voyous et 2 politiques se croisent, se servent, sans jamais oublier de se renvoyer l’ascenseur? Par le menu, les caïds décryptent l’organisation de la société du crime, ses règles, son code de l’honneur, son aristocratie.
Episode 3 : La Loi de la drogue
Cannabis, cocaïne, héroïne : la drogue a inondé le marché français, imposant sa loi et ses méthodes. Témoignent de nombreux acteurs de ce trafic, de l’ancienne garde des barons de la French Connection à la nouvelle génération des dealers, en passant par l’inventeur des go-fast entre Marbella et Paris.
Ainsi se dessine la manière dont le trafic s’est épanoui aux Etats-Unis avant de s’emparer de l’Espagne à l’époque de l’ETA. Aujourd’hui, avec plus d’un milliard de bénéfices par an rien qu’en Seine-Saint-Denis, cette «machine à cash» est devenue un contre-pouvoir, et les caïds des quartiers échangent la paix sociale contre la mainmise sur leurs territoires.
Les gangsters et la République : mariage et déraison (Marianne)
Entre les déboires judiciaires d’un Dassault à Corbeil et les éternels règlements de comptes marseillais, on retrouve une même matrice historique : les liaisons dangereuses qu’entretiennent le pouvoir et les bandits. Tel est le constat, implacable, qui s’impose avec « Les gangsters et la République », une enquête de notre collaborateur Frédéric Ploquin, livrée sous la forme d’une série documentaire événement en trois épisodes et prochainement diffusé sur France 5, couplé à un ouvrage non moins indispensable.
« Les gangsters traqués par la police de la République, c’est la version officielle. Une fiction. En vrai, ce sont des décennies de services rendus. ».
D’emblée, le ton est donné. Ploquin, grand reporter depuis plus de trente ans, résume bien les aveux explosifs livrés par ses trente-cinq témoins, de Charles Pasqua à l’ineffable Dodo La Saumure, acteur malgré lui de l’affaire DSK. Autant de portraits, regards et tirs croisés sur ces trafics au cœur d’un système protéiforme dans lequel élus, policiers, magistrats, politiques et affranchis trouvèrent leur compte.
Zones grises des années noires
Les racines du phénomène remontent aux Années noires, paroxysme de l’inversion des valeurs : la sinistre « Carlingue », Gestapo française sans laquelle les nazis n’auraient pu frapper aussi durement la Résistance, recrutait des malfrats qui, brandissant leur carte de la « police allemande », faisaient trembler les policiers. Mais d’autres truands choisirent le camp d’en face : leur savoir-faire en matière de clandestinité, ainsi qu’une capacité à appuyer plus volontiers sur la détente, ont créé des liens indéfectibles avec des patriotes engagés dans la lutte contre l’occupant.
« Quand on a connu les difficultés de l’Occupation, les risques que cela comportait, les pertes que nous avons eues les uns et les autres, on ne peut pas passer ça par profits et pertes du jour au lendemain », estime Charles Pasqua, qui, toujours en verve, accordait ici sa dernière interview.
Certains ont pu renvoyer l’ascenseur, à l’image d’Edmond Michelet, résistant sauvé par Jo Attia, ex-gestapiste français déporté comme lui à Mauthausen. Devenu ministre de la Justice, il couvrira ce colosse devenu barbouze. D’autres, comme les Francisci – une famille corse et résistante –, hériteront des principaux cercles de jeux de la capitale.
Jeux de dupes ?
« Je n’ai impulsé aucune politique, prévient Charles Pasqua à propos de ses années place Beauvau. J’ai laissé les choses se dérouler comme elles se déroulaient. »
C’est-à-dire un échange de bons procédés : lieux en vue du Tout-Paris qui seront parfois dirigés par d’anciens flics de haut rang, les cercles de jeu aimantaient des repris de justice sur lesquels il était alors aisé de recueillir des informations, comme le rappelle Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI (renseignement intérieur).
Avec maintes figures du showbiz, les « hommes politiques accrocs à la cocaïne à cent pour cent » décrits par l’ex-trafiquant Gérard Fauré furent ainsi fichés parmi les 40 000 dossiers à la disposition du préfet de police, Maurice Papon. « Ce qu’il souhaitait, raconte le grand flic Lucien-Aimé Blanc, c’était avoir des papiers sur tout le monde. »
Autres sources, les boîtes de nuit et les hôtels de passe (jusqu’à 143 à Paris), dont les patrons et le personnel distillaient des tuyaux et… du liquide :
« Les proxos filaient la dîme aux condés, ils balançaient aussi certainement, comme ça ils étaient tranquilles », déclare William Perrin, né au début des années 1930 et devenu souteneur avant ses quinze ans. Les « hôtelierscouverts » par la police généraient de surcroît un flot de cash employé à des fins politiques : pour financer la lutte anti-OAS, le directeur de la PJ fit ainsi « couvrir » une demi-douzaine de bordels prospères.
La main dans le SAC
S’affranchir des lois pour mener un combat supposé juste ?
« Ce modèle rodé pendant l’Occupation va resservir chaque fois que la France sera en danger, notamment pendant la guerre d’Algérie, ou que le gaullisme sentira le vent du boulet, notamment face aux communistes », analyse Ploquin.
De fait, le Service action civique (SAC) voit le jour en 1958, avec le retour du Général. Comme en atteste l’historien Jean-Marc Berlière, on retrouve, parmi ses responsables, un certain Charles Pasqua, qui ne se départira jamais d’un culte du secret propre à cette police parallèle : « Un des responsables du SAC, c’est un peu excessif », louvoie l’ex-ministre de l’Intérieur, qui évoque à son sujet un service d’ordre musclé. « Ils foutaient la trouille, ces gens du SAC ! », se souvient néanmoins l’ancien ministre de l’Intérieur Daniel Vaillant.
« Ils formaient une sorte de milice qu’on a retrouvée dans certaines manifestations qu’ils étaient chargés de dénaturer, en cassant les vitrines des magasins sur le parcours », témoigne Bernard Deleplace, entré dans la police comme gardien de la paix en 1964, et ex-dirigeant de la Fédération autonome des syndicats de police.
Commandos de la mort
Les recrues de ce service bien peu « civique » combattent surtout le FLN, voire l’OAS au sein de « commandos de la mort à la française » associant flics et bandits, anciens résistants et collabos : Georges Boucheseiche, récupéré par les services en dépit (ou en raison) de son passé de gestapiste français, fut impliqué en octobre 1965 dans l’enlèvement de Mehdi Ben Barka, avec deux policiers.
« On pouvait même leur demander d’aller tuer des gens. Et quand on n’avait plus besoin d’eux, on les liquidait », raconte l’incontournable William Perrin.
Boucheseiche, lui, disparut au Maroc dans d’obscures circonstances. On proposera même à Perrin d’éliminer le dernier membre de l’opération Ben Barka. Georges Figon – car c’est de lui dont il s’agit – s’est officiellement suicidé lors de son arrestation.
« Ils allaient et venaient, à tuer, à voler, et la police fermait les yeux, complète Gérard Fauré, autrefois « prince de la cocaïne ». « Ils partageaient leurs gains avec des politiques qui leur filaient des coups. […] Tous les ministres de l’Intérieur qui se sont succédé à l’époque étaient dans le coup. »
Territoires abandonnés
« L’histoire des cités en France démarre au XVIe siècle avec la création de la ‘‘lieue du ban’’, qui va devenir la banlieue », rappelle le criminologue Alain Bauer. « C’est en 1921 que la question de la sécurisation s’est posée dans les HLM, qui étaient à l’époque des HBM », poursuit Bauer, qui voit les années 1980 comme un tournant majeur :
« Avec les premières émeutes urbaines, aux Minguettes, à Lyon, on s’aperçoit subitement qu’on a concentré dans des endroits spécifiques plusieurs ghettos en un seul. Ghetto d’immigrés, ghetto de pauvres, ghetto urbain. »
C’est dans ce contexte qu’émergent les caïds des cités, « nouveaux notables », produits d’une faillite républicaine. Celui qui se confie face à la caméra sous le pseudonyme de « Sakho » était l’un d’eux : ex-trafiquant du 93 et aujourd’hui quadra sans histoires, il fut happé par le « biz » au début des années 1980 :
« Plus tu montes, plus tu es le roi (…) Les élus de la mairie comptent sur toi pour que les gens, au quartier, pensent comme eux et surtout votent pour eux. »
Ces mêmes élus comptent aussi sur lui pour instaurer la paix sociale. « D’une certaine façon, on faisait la police à côté de la police », assure Sakho. Quand les Brigades anti-criminalité débarquent et jouent au cowboys, les répliques sont toutes trouvées :
« On laissait quelques billets dans la boîte à gants, ils les prenaient quand ils nous contrôlaient et nous laissaient tranquilles. » Autre option : menacer la mairie d’une farandole de voitures brûlées dont les images diffusées au 20 heures font toujours tache…
En parallèle, on voit émerger les « grands frères », ces figures plus ou moins délinquantes portées par les pouvoirs locaux pour calmer les tensions dans ces quartiers où l’on vote de moins en moins. En prime, des subventions versées à des associations fictives, des emplois municipaux ou des logements permettaient à ces élus de se constituer une clientèle. Résultat : « Ces nouveaux notables sont carrément devenus les bras droits des maires. »
Au vu et au su de tous
« Est-ce que l’Etat doit être complice d’une économie parallèle clandestine qui par ailleurs alimente des réseaux que l’on combat sérieusement ? », s’insurge l’ancien ministre Daniel Vaillant ?
Le magistrat Sébastien Piffeteau, procureur à Bobigny, pointe justement du doigt le fait que cette économie n’a rien de souterrain :
« Elle se fait au vu et au su de tous. (…) Il suffit d’avoir des yeux pour observer ce qui se passe. » Reste que prévenir et traiter le problème de la délinquance nécessite des moyens qui font défaut, et la gangrène se propage :
« Certains élus m’ont indiqué que les prochaines personnes influentes, y compris validées par le suffrage universel, seraient des gens impliqués dans le trafic de produits stupéfiants. »
N’est-ce pas déjà le cas ? Récemment, Piffeteau démantelait un trafic de cocaïne dans lequel était mouillé un fonctionnaire important de Bagnolet, alors quatrième ville la plus endettée de France…
Le crime ne paie pas, dit-on. Pourtant, en France, les criminels s’associent souvent aux politiques (et aux policiers !) pour maximiser les gains de chaque parti. L’histoire de ces accords entre le Milieu et les acteurs du pouvoir commence sous l’occupation allemande, pendant la Seconde Guerre Mondiale, et n’a pas vraiment pris fin depuis. Qui sont les gangsters de la République ?
Atlantico : Dans votre ouvrage Les gangsters et la République, publié aux éditions Fayard, vous écrivez notamment que l’histoire de la relation entre République et voyoucratie est une « histoire de compromission ». Quand commencent véritablement les accords entre brigands et politiques en France ? Quelles en sont les raisons premières ?
Frédéric Ploquin : Il existe une matrice à toutes ces compromissions. Cela débute pendant la Seconde Guerre Mondiale, pendant les périodes de l’occupation nazie puis de la libération du territoire par la Résistance. Les deux partis en présence avaient alors besoin des gangsters et se sont servis d’eux. D’un côté, les nazis avaient besoin des gangsters pour mener des razzias et, paradoxalement, pour faire la police (il s’agissait notamment de tenir les policiers résistants qui étaient parfois récalcitrants) et ont installés les voyous au sommet du pavé.
De l’autre, la Résistance a fait appel aux bandits pour leur savoir-faire, dont elle ne disposait pas nécessairement. Le voyou a plus d’un avantage : tuer ne l’effraie pas, voler ne lui pas fait pas peur non plus. Éliminer quelqu’un n’est pas toujours simple, le dépouiller n’est pas forcément beaucoup plus facile. Dans un cas comme dans l’autre, tant chez les nazis que dans la Résistance, les voyous exécutent les basses-besognes.
Ce qui ne signifie pas pour autant que passé la libération, l’histoire de la compromission s’arrête après la guerre. Cette matrice ressert à plus d’une occasion, à la Libération et ensuite. Les premiers à faire la paix entre eux sont les voyous : ceux qui travaillaient pour les Allemands et ceux qui travaillaient pour la Résistance travaillent ensuite main dans la main et exploitent leurs carnets d’adresses. Un très bon exemple des relations que cela engendre est celle qui lie Jo Attia, truand parisien et membre du Gang des Tractions Avant et Edmond Michelet, qui deviendra Garde des Sceaux après la guerre. Les deux hommes se sont croisés dans les camps de concentration. À chaque fois qu’Attia semble inquiété par une affaire judiciaire, Edmond Michelet se portera témoin de moralité, le rendant proprement intouchable. Cette anecdote, loin d’être la seule, est symptomatique des relations incestueuses entre les acteurs politiques et la voyoucratie. En plus d’être cocasse, elle est instructive des liens de l’époque.
Toute une classe politique française, qui va régner durant la Vème République est précisément issue de cette culture, dont l’un des exemples les plus parlant est bien Gaston Defferre. Toute cette classe politique va conserver ces « mauvaises habitudes ». Quand la France est en guerre, cela se justifie. Pour aller contre le FLN, durant la guerre d’Algérie, le pouvoir Gaulliste va monter des réseaux parallèles, les utiliser sur le terrain et les envoyer en Algérie. En guerre, cela peut évidemment s’avérer utile. Après quoi, cela donne cependant lieu à une nouvelle mouture sous la forme du SAC, le Service d’Action Civique. Il s’agit d’une forme de police parallèle créée par les gaullistes – qui n’ont pas confiance dans la police officielle. Ils s’appuient donc sur des gangsters pour tenir la rue. Le voyou tient les trottoirs, les territoires. Il me semble important de rappeler que la politique de l’époque n’était pas similaire à celle menée aujourd’hui : les violences étaient régulières, à chaque campagne, comme à chaque meeting. La nécessité de garde du corps est réelle. C’est un domaine dans lequel s’engouffrent les gangsters.
Dans cet ouvrage, je raconte 50 années de services, réciproques. Il ne faut jamais croire que le gangster va rendre service à la République uniquement parce qu’il aime le drapeau. Le gangster est avant tout amateur de pognon, au point qu’on puisse parler de « pognoniste ». S’appuyer sur un voyou, le recruter, quelle que soit la tâche, n’est pas gratuit. Il faut évidemment s’attendre à ce qu’il se paye sur la bête.
Quels sont les liens qui unissent les malfrats et l’Etat ? Dans leur documentaire, Frédéric Ploquin, spécialiste du banditisme, et Julien Johan explorent les dessous d’une association vieille comme le monde. Nous avons cuisiné le premier, il s’est mis à table.
Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste du banditisme, propose dans le documentaire en trois parties Les Gangsters et la République (sur France 5) une version officieuse de l’histoire de la France contemporaine. Son angle d’attaque : les liens et les intérêts communs qui unissent depuis la Libération truands, policiers et monde politique. Nous l’avons rencontré.
Pourquoi aborder ce sujet aujourd’hui ?
Il y avait une urgence à recueillir une parole qui allait disparaître. Les gangsters qui ont connu la Libération et la criminalité des années 50 atteignent un âge canonique au-delà duquel ils ne pourront plus s’exprimer. J’ai senti qu’une mémoire allait disparaître et qu’il fallait rapidement les entendre. J’en connais certains depuis quinze, voire vingt ans ; je suis parfois allé les rencontrer en prison. Il y a un lien de confiance. Je savais qu’il n’y aurait pas trop de problèmes pour les filmer. Et, effectivement, j’ai constaté que notre relation se poursuivait comme si la caméra n’était pas là.
Par ailleurs, il y a une dizaine d’années, je me suis lancé dans un portrait de la voyoucratie française – du grand banditisme traditionnel aux caïds contemporains – dans mon livre Parrains et Caïds. Je me suis dit qu’il fallait donner du sens à tout cela. Et ce sens ne peut être que politique.
L’idée de départ du documentaire est de montrer comment la République s’est toujours servie des voyous…
J’ai voulu éclairer le politique par le fait divers, et raconter l’envers du décor : derrière le discours officiel qui clame que « la police traque les voyous », il y a une réalité très différente. Depuis que la République est république, elle s’arrange avec le crime. Regarder ce phénomène en face, c’est apporter un vrai éclairage sur son fonctionnement.
Je considère que la période de l’Occupation a été une matrice où se sont noués les liens entre la sphère politique et le monde du crime. Ce modèle a servi à toutes les périodes, notamment pendant la guerre d’Algérie, et on le retrouve sous une autre forme dans le clientélisme appliqué aux cités, que ce soit en région parisienne ou à Marseille.
A la Libération, l’argument qui justifiait ces « arrangements » était patriotique. Il fallait défendre le drapeau par tous les moyens… Est-ce toujours le cas ?
La constante c’est le donnant-donnant. Avec les voyous, ça ne peut marcher que comme ça. A une époque, ils pouvaient tuer pour le compte de l’Etat, enlever des gens, remplir des caisses financières… Aujourd’hui, ils sécurisent la vie politique de l’élu local dans les quartiers : ils lui permettent de faire sa propagande ou sa campagne électorale. Eventuellement ils font voter les habitants car ils ont le contrôle d’un territoire. Ils sont un appui pour le politique.
Jusqu’à quel point avez-vous senti que la parole des témoins était libre ?
Je trouve que la parole de mes témoins est assez libre. Je me suis appuyé sur des gens que je connais bien, qui ne pratiquent pas la langue de bois. Renaud Muselier, par exemple, joue le jeu à fond. Le fait de mettre face à face la parole des voyous et celle des politiques permet de faire comprendre beaucoup de choses aux téléspectateurs, y compris dans les silences et la formulation d’une réponse. J’ai par ailleurs fait appel à un certain nombre de policiers et de magistrats qui se lâchent particulièrement.
Quelles impressions gardez-vous de votre interview de Charles Pasqua ?
Je le connaissais bien : j’ai beaucoup écrit sur lui à l’époque où je travaillais à l’Evènement du jeudi. Certaines unes nous ont valu des batailles judiciaires. Il connaissait ma façon de travailler. Il refusait cet interview depuis un an. Mais – ça peut sembler étrange – c’est finalement lui qui m’a appelé, en personne, pour me donner rendez-vous à la bibliothèque du Sénat. Il sentait peut-être que la fin était proche et qu’il devait s’exprimer. C’était trois semaines avant sa mort.
Ce jour-là, je pense qu’il a parlé sincèrement, les yeux dans les yeux. Ses silences et ses moues sont plus forts que des aveux. On a gardé le moment intéressant où son conseiller en communication intervient pour lui venir en aide. Mais ce n’est pas quelqu’un qui avait besoin d’aide.
Quel peut être l’impact d’une telle enquête à quelques mois de l’élection présidentielle ?
Mon idée n’est pas de dénigrer les politiques ou le travail de la police. Le film tente d’éclairer des relations qui existent et qui ont toujours existé. On montre que les voyous ont rendu de vrais services à la République et, qu’à côté de cela, il y a eu des dérapages. Dire les choses telles qu’elles sont ne peut être que bénéfique. Cet éclairage ne pouvait peut-être pas venir de journalistes dits politiques, qui sont enfermés dans un autre discours.
Avez-vous fait attention à ne pas tomber dans une forme de glorification de la figure du truand ?
C’est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours. Je ne juge pas moralement les bandits, sinon je ne pourrais pas discuter avec eux. Et ils ne me fascinent pas. J’espère que cela se voit dans les films. On les écoute mais on n’en fait pas des super-héros. Ce sont des gangsters, des hors-la loi. Et ils le restent. Une bonne partie de l’histoire de France s’est écrite avec ces hors-la-loi : c’est cela qu’il fallait raconter.
Jusqu’où peut-on mettre au jour cette réalité souterraine ?
La vraie limite, c’est la diffamation. Il y a des choses que je sais mais sans pouvoir en apporter la preuve. Tel voyou nous a dit qu’il vendait de la cocaïne à tel homme politique. Un autre nous a raconté qu’un bandit corse a tué je ne sais combien de personnes en Afrique noire pour le compte de la France… Il était impossible de garder cela dans les films. Je pense que nous sommes allés au bout de ce que nous pouvions démontrer. Sur la mafia corse, par exemple, l’éclairage d’anciens policiers et d’historiens donnent un contre-champ intéressant, qui permet de ne pas être uniquement à charge.
Sur les affaires liées au SAC (le Service d’action civique, qui fut la police parallèle du régime gaulliste), notamment, il reste de nombreuses zones d’ombre…
Les témoins de cette époque disparaissent les uns après les autres et il n’y a pas de traces écrites. Je voulais montrer à la jeune génération, pour qui le SAC est très lointain, la réalité étonnante de cette organisation : le service d’ordre du parti au pouvoir s’appuyait sur des hors-la-loi, eux-mêmes protégés par des policiers. A l’époque, des voyous se baladaient avec des cartes tricolores…
Le troisième volet du documentaire décrypte une affaire de trafic de drogue à Bagnolet qui impliquait des employés municipaux. Pourquoi avoir retenu ce dossier et cette ville en particulier ?
Je voulais que les téléspectateurs comprennent que Marseille n’est pas la seule ville touchée par le clientélisme. Il y a des cas partout sur le territoire. L’affaire de Bagnolet m’intéressait car je l’ai suivie depuis le début et jusqu’au procès. C’est un cas d’école, symptomatique. Les trafiquants utilisaient un local technique municipal pour cacher la drogue. Et, à coté de cela, des voyous assuraient le service d’ordre au conseil municipal… Finalement, on pourrait presque transposer la situation aux années 50 et 60 lorsque les politiques avaient besoin des voyous pour coller des affiches et jouer les gros bras dans les meetings. C’est frappant.
Lorsque vous entendez des discours sur la transparence et l’intégrité de la part des politiques, quel est votre sentiment ?
Je ne suis pas du tout un aigri. Je ne considère pas que le droit et la République ont perdu. Faire ce film aujourd’hui, c’est aussi une façon de montrer que la République doit dépasser ce phénomène. Il y a encore de la place pour des juges et des policiers soucieux de faire leur boulot. J’en connais beaucoup.
Mais il ne faut pas non plus se cacher derrière des grands principes et interdire aux policiers d’avoir des contacts dans la voyoucratie pour avancer. Une part de ces petites arrangements sont nécessaires au fonctionnement de la République. La question est de savoir où ça s’arrête. Certains en abusent, se laissent prendre dans l’engrenage. Mais il n’y a pas de fatalité : tous ne tombent pas.
L’édito de Jacques Pradel
A la Une aujourd’hui l’enquête du journaliste Frédéric Ploquin sur les liaisons dangereuses entre les Gangsters et la République, qui, certes, traque les voyous, mais n’hésite pas non plus, depuis des décennies, à demander à des gangsters d’effectuer quelques basses besognes inavouables.
Ce pourrait être une rumeur, c’est une réalité ! Les voyous, les politiques, et les policiers que Frédéric Ploquin a rencontré dans son enquête lui ont confirmé l’existence de cette « porosité » entre deux mondes qui ne devraient pas se rencontrer !
Nos invités :
Frédéric Ploquin, journaliste à Marianne, spécialiste du grand banditisme. Auteur du livre « Les gangsters et la République » qui parait aujourd’hui chez Fayard. Il est aussi l’auteur d’une série documentaire (3×52’) intitulée « Les gangsters et la république » qui sera diffusée le dimanche 9 octobre à 20h45 sur France 5.